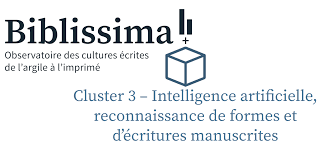|
Accueil Biblissima+ (Observatoire des cultures écrites, de l’argile à l’imprimé), porté par le Campus Condorcet, est l’un des équipements structurants pour la recherche ÉquipEx+ financés dans le cadre des Investissements d’avenir. Il prend le relais de l’ÉquipEx Biblissima (Bibliotheca bibliothecarum novissima) et crée une infrastructure numérique multipolaire de recherche fondamentale et de service consacrée à l’histoire de la transmission des textes anciens, des premières tablettes d’argile mésopotamiennes aux premiers livres imprimés, sur tous les supports et dans toutes les langues. Biblissima+ s'articule autour de 7 domaines d'expertise ou « clusters » organisés selon le cycle de vie des données. Les travaux du Cluster 3 “Intelligence artificielle et la reconnaissance de formes et d’écritures manuscrites”, coordonné par Dominique Stutzmann (directeur de recherche, IRHT – CNRS) et Daniel Stökl Ben Ezra (directeur d'études, EPHE-PSL, AOROC UMR 8546) portent sur l’exploitation de l’intelligence artificielle pour la reconnaissance de formes, de caractères et d’écritures manuscrites permettant l’étude du livre ancien manuscrit et imprimé, la sigillographie, la numismatique et l’héraldique. Il s’agit de traiter de données massives et diverses, tant par les matériaux que par les langues et les systèmes d’écriture qui intéressent Biblissima+. Les travaux du cluster seront menés en étroite collaboration avec les autres clusters pour formaliser le texte, exploiter l’image, lire le texte et le comprendre. Le cluster cherche à ouvrir l’accès aux infrastructures et aux données et à fournir à l’utilisateur les outils les plus puissants possibles tout en respectant la finesse et la diversité des recherches historiques. Biblissima+ bénéficie d’une aide de l'Etat gérée par l'ANR au titre du Programme d’investissements d’avenir intégré à France 2030, portant la référence ANR-21-ESRE-0005. Cette journée du cluster 3 de Biblissima+ pour l'année 2025 entend participer à la réflexion sur le futur des formations offertes pour les communautés autour de l'analyse des manuscrits médiévaux par intelligence artificielle. A ce titre, cette journée du cluster 3 est organisée sous la forme d'un séminaire de réflexion sur la formation doctorale future au niveau européen. Ce séminaire sur invitation avec des acteurs et actrices de cette communauté se tiendra toute la journée, sous le thème "un réseau doctoral pour demain M3D - Medieval Manuscripts - From Material to Digital and Back", avec une table-ronde publique en fin de journée.
Thème 2025 : le futur de la formation doctorale (M3D - Medieval Manuscripts From Material to Digital) Le Moyen Âge européen est souvent mal représenté ou instrumentalisé, tant dans la recherche que dans la société et les médias. L'accès croissant aux données numériques et aux images des manuscrits médiévaux — notre principale source d'information sur cette période — offre une opportunité de transformer en profondeur ce récit et d'élargir considérablement notre connaissance de cette époque. Cependant, un obstacle subsiste : le monde académique ne dispose ni des compétences techniques ni des outils pour exploiter pleinement ce flux massif de nouvelles données. Leur création comme leur étude se font de manière fragmentée, sans direction claire ni standardisation méthodologique ou conceptuelle. Pour dépasser cet état de fait, il est nécessaire de forger des liens interdisciplinaires stables et durables, de créer un nouveau paradigme dans l’usage des manuscrits médiévaux comme sources historiques, et de former une nouvelle génération de chercheurs capables d'utiliser ces données, d'appliquer les technologies, et de poser de nouvelles questions. Un réseau doctoral constitue donc l’environnement idéal pour atteindre ces objectifs. Grâce à ce réseau, nous pouvons élaborer un nouveau paradigme pour l’étude et la représentation du Moyen Âge, centré sur les manuscrits médiévaux, nos sources les plus riches et pourtant encore largement sous-exploitées. Les manuscrits médiévaux, c’est-à-dire le patrimoine écrit de l’Europe médiévale, constituent un champ de recherche dynamique, interdisciplinaire et hautement symbolique, tant à l’échelle européenne que mondiale, où l’intelligence artificielle opère une véritable révolution — non seulement pour les chercheurs, mais surtout dans la manière dont le grand public voit, interprète, interagit avec, diffuse et s’approprie le passé. L’abondance de contrefaçons et de faux documents, qui alimentent des théories du complot fondées sur des événements ou objets historiques réels ou inventés, tout en effaçant la complexité historique, représente un enjeu majeur. Depuis les années 1990, la numérisation croissante des collections patrimoniales, aujourd’hui amplifiée par la décennie numérique de l’Europe, a généré une immense disponibilité de sources, à la fois pour la consultation humaine et l'entraînement d’outils d’IA (notamment générateurs d’images), augmentant les risques de mésinterprétation et d’instrumentalisation du Moyen Âge. Qu’elle soit volontaire ou due à une confiance excessive dans les outils, cette mauvaise utilisation (vision artificielle, analyse d’image, reconnaissance d’écriture manuscrite, traduction automatique, hallucinations) entraîne au pire de nouvelles erreurs, au mieux une répétition d’interprétations obsolètes héritées de biais dans les modèles d’apprentissage. Le Moyen Âge occidental se distingue particulièrement dans le discours public : tantôt idéalisé comme une source de légendes héroïques ou nationales (Blanc et Naudin 2015 ; Cooper 2023), tantôt présenté comme un modèle de société « blanche », homogène et pieuse sous le contrôle de l’Église chrétienne ; tantôt caricaturé négativement à travers des termes comme « médiéval », « obscur », « barbare », associés à une société oppressante et figée. Les références au Moyen Âge foisonnent, tant dans la culture populaire que savante (ex. Le Nom de la rose, Le Seigneur des anneaux, Harry Potter, Game of Thrones, ou encore Written on Skin de G. Benjamin). Cette association entre l’Europe et son Moyen Âge est aussi exploitée en dehors du contexte occidental (ex. : croisades). Cet enjeu sociétal majeur requiert une nouvelle génération de chercheurs dotés d’une expertise combinée dans plusieurs domaines :
Or, aucune école doctorale en Europe ne propose actuellement une telle formation interdisciplinaire de haut niveau. L’objectif scientifique principal du projet M3D - Medieval Manuscripts From Material to Digital est donc de créer une communauté de jeunes chercheurs et chercheuses, capable de traiter conjointement les problématiques, méthodes et évolutions des études manuscrites, de l’histoire numérique et de l’informatique. Trois catégories d’objectifs de recherche concourent à ce but : disciplinaires, interdisciplinaires et sociétaux. Mais d’abord : Pourquoi les manuscrits médiévaux ? Parce qu’ils sont les témoins les plus riches de la culture et des mentalités médiévales, et constituent une source d’information inépuisable sur le passé. Leur étude mobilise de nombreuses disciplines — philologie, diplomatique, paléographie, codicologie, histoire, histoire de l’art, études littéraires et culturelles — qui restent cependant souvent cloisonnées (Rouse-Rouse-Baswell 2011 ; Mostert 2012 ; Bausi et al. 2015). Le manuscrit médiéval est un objet complexe et multiforme. Longtemps analysé séparément comme support de texte ou d’image selon les spécialités, il est désormais étudié dans toute sa complexité textuelle, physique et historique. Les textes sont analysés dans leur fluidité, à travers les processus de transmission, chaque témoin constituant un cas unique. Cette complexité physique a donné lieu à une approche plus holistique des relations texte/image, débouchant sur une discipline dédiée — la codicologie ou « archéologie du livre ». Cette approche considère que les aspects matériels du manuscrit participent pleinement à la transmission des idées (Barret, Stutzmann et Vogeler 2016 ; Treharne 2021), et que tous les éléments d’un manuscrit coopèrent pour communiquer un message (Andrist-Canart-Maniaci 2013 ; Quenzer 2021). Ces dimensions sont intégrées dans l’histoire sociale, économique, environnementale et même biologique : commerce des pigments africains, importation de techniques asiatiques (production de papier), compréhension de la production et transmission intellectuelle avec des modèles biologiques (Camps-Randon-Furling 2022 ; Kestemont et al. 2022). L’analyse de l’information contextuelle (origine, provenance, altérations, réemplois) s’affirme, tout comme l’étude de la composition des volumes (copies luxueuses ou carnets personnels), qui modifie profondément la perception, l’interprétation et la réception des textes (Friedrich-Schwarke 2016 ; Nichols-Wenzel 1996). Cependant, les interactions dynamiques entre les textes et leur présentation à toutes les étapes de l’histoire d’un manuscrit ne sont pas formalisées et ne peuvent être opérationnalisées. Les catégories traditionnelles projetées par les chercheurs brouillent plus qu’elles n’éclairent la compréhension des manuscrits, et induisent un biais fort dans les données disponibles, rendant la question des mécanismes de la transmission du savoir médiéval actuellement insoluble (Cermanová-Zurek 2021 ; Pratt et al. 2017). Inscrit dans une dynamique transdisciplinaire qui applique les méthodes numériques à de vastes corpus manuscrits (Maniaci 2022 ; Stokes 2021), M3D veut aborder les manuscrits médiévaux dans leur complexité, en identifiant trois domaines fondamentaux de confusion et d’incertitude, encore mal maîtrisés sur les plans théoriques, méthodologiques et techniques :
Dans ces trois axes, les lacunes scientifiques, les limites des modèles et des outils disponibles, freinent la progression de nos connaissances et la transmission d’une compréhension enrichie du passé. Ces domaines constituent donc les trois Work Packages (volets de recherche) du projet.
Table ronde conclusive "Medieval Manuscripts From Material to Digital: the Future of Doctoral Training at the Crossroads of Manuscript Studies and AI" La table ronde conclusive "Medieval Manuscripts From Material to Digital: the Future of Doctoral Training" est publique et gratuite. L'inscription est obligatoire (suivre ce lien). La langue de discussion sera l'anglais. Elle abordera, outre les contenus disciplinaires, les thèmes du contenu et de l'organisation d'une formation incluant des savoir-faire et savoir-être transférables et intersectoriels, inclusivité et qualité de la supervision. Participants: Shari Boodts Professeur à la Radboud University à Nimègue. Lucie Doležalová Professeur à l'Univerzita Karlova à Prague. Mark Faulkner Professseur à Trinity College à Dublin. Franz Fischer Professeur à l'Università Ca' Foscari à Venise. Alicia Fornés Senior researcher à l'Universitat Autònoma de Barcelone (UAB). Christopher Kermorvant PDG de TEKLIA. Mike Kestemont Professeur à l'université d'Anvers. Peter Stokes Directeur d'études à EPHE-PSL. Dominique Stutzmann Directeur de recherche au CNRS (IRHT - UPR841). Georg Vogeler Professeur à la Karl-Franzens-Universität à Graz. |